Dans le tumulte des relations commerciales, un client qui ne règle pas sa commande met en péril non seulement la trésorerie immédiate de l’entreprise, mais aussi sa stabilité financière à moyen terme. En 2025, à l’heure où la digitalisation accélère les échanges et les transactions, le non-paiement demeure une difficulté majeure que doivent surmonter les professionnels. Heureusement, dépassant les simples rappels au téléphone, la législation française encadre un arsenal robuste de recours juridiques, de la mise en demeure à la procédure judiciaire, en passant par des efforts de médiation et de recouvrement amiable qui préservent parfois la relation commerciale. Ces solutions, en partie facilitées par la collaboration avec des huissiers de justice ou la saisine du tribunal de commerce, visent à répondre efficacement aux créances impayées tout en sécurisant l’entreprise contre des pertes trop lourdes. Revenons sur ce cadre légal enrichi d’exemples concrets et d’outils pratiques indispensables pour tout professionnel confronté à l’épineux problème des impayés.
Les démarches amiables comme première étape incontournable face au non-paiement de commande
Avant d’envisager une procédure judiciaire, la priorité doit être donnée aux démarches amiables, qui se révèlent souvent plus rapides, moins coûteuses, et préservent la relation client. La législation, notamment depuis la loi Macron de 2015, impose en effet de prouver une tentative de résolution à l’amiable avant toute action judiciaire. Le plus souvent, cela débute par une relance simple ou téléphonique.
Une relance téléphonique, bien menée, permet d’identifier la raison du retard : problème de trésorerie, erreur administrative, désaccord sur la commande, ou simple oubli. Imaginons un artisan qui contacte son client pour éclaircir le retard de paiement : en quelques minutes, il peut souvent débloquer la situation sans qu’il soit nécessaire d’aller plus loin.
Si ce premier contact ne suffit pas, une lettre recommandée de relance ou une mise en demeure doit être envoyée. Ce courrier, daté et signé, représente un document clé qui va formaliser la demande. La mise en demeure doit impérativement mentionner :
- L’identité complète des parties, acheteur et vendeur.
- La référence précise de la commande et le montant dû.
- Un délai accordé pour payer, généralement entre 7 et 15 jours.
- La mention des intérêts dus en cas de retard, selon l’article 1231-6 du Code civil.
La mise en demeure produit un double effet : elle déclenche la course des intérêts moratoires, ce qui signifie que le client en retard commence à vous devoir des pénalités automatiquement. De plus, ce document constitue souvent un prérequis obligatoire pour entamer toute procédure judiciaire ultérieure. Pour approfondir, voyez l’exemple d’une clause pénale insérée dans un contrat : « En cas de retard de paiement, une pénalité de 10% sera appliquée automatiquement. » Cette clause, conforme à l’article L.441-6 du Code de commerce, protège le fournisseur et dissuade les mauvais payeurs.
Voici un tableau récapitulatif des étapes des recours amiables face à un non-paiement :
| Étape | Description | |
|---|---|---|
| Relance téléphonique | Contact direct pour comprendre le retard de paiement | Réagir rapidement et débloquer la situation |
| Lettre recommandée de relance | Rappel formel et notification du retard | Obtenir un engagement de paiement écrit |
| Mise en demeure | Dernier avertissement avant recours judiciaire | Activer les intérêts moratoires et constituer une preuve |
En maîtrisant ces étapes, l’entreprise optimise ses chances d’obtenir le règlement sans passer par la case tribunaux. Le recours à la médiation peut aussi être privilégié avant une action judiciaire, parfois avec l’aide d’un huissier de justice ou d’un médiateur professionnel qui facilitera la négociation.

Les recours judiciaires face à la défaillance de paiement : injonction de payer, référé, et assignation
Lorsque les démarches amiables n’aboutissent pas, passer aux procédures judiciaires s’impose. Parmi celles-ci, la procédure d’injonction de payer figure souvent en tête de liste pour sa simplicité et sa rapidité.
L’injonction de payer ne nécessite pas d’audience. Le créancier doit constituer un dossier solide avec preuves contractuelles (facture, bon de commande, devis) et déposer une requête auprès du tribunal compétent : le tribunal judiciaire pour les particuliers ou le tribunal de commerce pour les professionnels. Après examen, une ordonnance est rendue. Si le débiteur ne s’oppose pas dans un délai d’un mois, cette ordonnance devient un titre exécutoire, autorisant alors le recours au recouvrement forcé, notamment par un huissier de justice.
Illustration concrète : une PME parisienne obtient ce titre pour une facture impayée de 8 000 €. Le commissaire de justice procède alors à une saisie sur le compte bancaire du débiteur, solution ultime pour assurer le recouvrement.
Le référé-provision constitue une autre voie rapide réservée aux créances non sérieusement contestables. Devant le tribunal, une audience sommaire peut donner lieu à une décision immédiate ordonnant le paiement, qui a valeur de titre exécutoire. Un graphiste auto-entrepreneur a ainsi récupéré 4 500 € auprès d’un client défaillant grâce à cette procédure.
Enfin, l’assignation au fond représente le dernier recours face à des litiges complexes, lorsque la dette est contestée. Cette procédure engage un contentieux plus long et souvent la présence d’un avocat est obligatoire, notamment pour des montants supérieurs à 10 000 €. Elle permet d’obtenir un jugement complet sur la créance et ses éventuelles conséquences, dont les frais de justice indemnisés via l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour vous aider à mieux comprendre ces processus, voici un tableau synthétique des options judiciaires et de leurs particularités :
| Procédure | Caractéristiques | Délai | Avantages |
|---|---|---|---|
| Injonction de payer | Sans audience, simple, nécessite preuve écrite | 1 à 3 mois | Rapide, peu coûteuse |
| Référé-provision | Audience rapide, créance incontestable | Quelques semaines | Titre exécutoire immédiat |
| Assignation au fond | Procédure longue, contentieuse | Plusieurs mois | Jugement complet, possible indemnités |
Pour approfondir, consultez les ressources sur la procédure judiciaire et les recours juridiques en cas de non-paiement.
Le rôle clé de l’huissier de justice dans le recouvrement des créances impayées
Au moment où la procédure judiciaire aboutit à un titre exécutoire, l’intervention d’un huissier de justice devient souvent indispensable. Ce professionnel a en charge la mise en œuvre du recouvrement forcé, qui peut se traduire par des saisies sur les biens mobiliers, les comptes bancaires ou encore les salaires du débiteur.
Plus qu’un simple exécutant, l’huissier joue aussi un rôle de conseiller et de médiateur. Sa lettre recommandée, même avant la phase contentieuse, peut débloquer certaines situations grâce à la pression qu’elle impose légalement au débiteur. Par ailleurs, son expertise permet de cibler efficacement les biens ou ressources saisissables, limitant ainsi les coûts et les délais pour le créancier.
Exemple marquant : une société de services a confié son dossier de recouvrement à un huissier qui, après jugement favorable, a procédé à la saisie d’un véhicule appartenant au débiteur récalcitrant, garantissant ainsi le paiement de la dette.
Il est important de noter que les frais liés à l’intervention de l’huissier sont généralement à la charge du débiteur, ce qui incite financièrement celui-ci à régulariser sa situation rapidement. Cependant, en cas d’échec du recouvrement, ces coûts peuvent, dans certaines situations, revenir au créancier.
Voici une liste des interventions principales d’un huissier durant un recouvrement :
- Envoi de lettres de relance sous forme de lettre recommandée.
- Organisation de médiation avant la saisie.
- Exécution des saisies des biens mobiliers et immeubles.
- Saisies bancaires et sur salaire.
- Remise d’assignations judiciaires.
Pour en savoir plus sur les possibilités offertes par ce professionnel, vous pouvez consulter l’onglet pratique chez LRF Avocats.
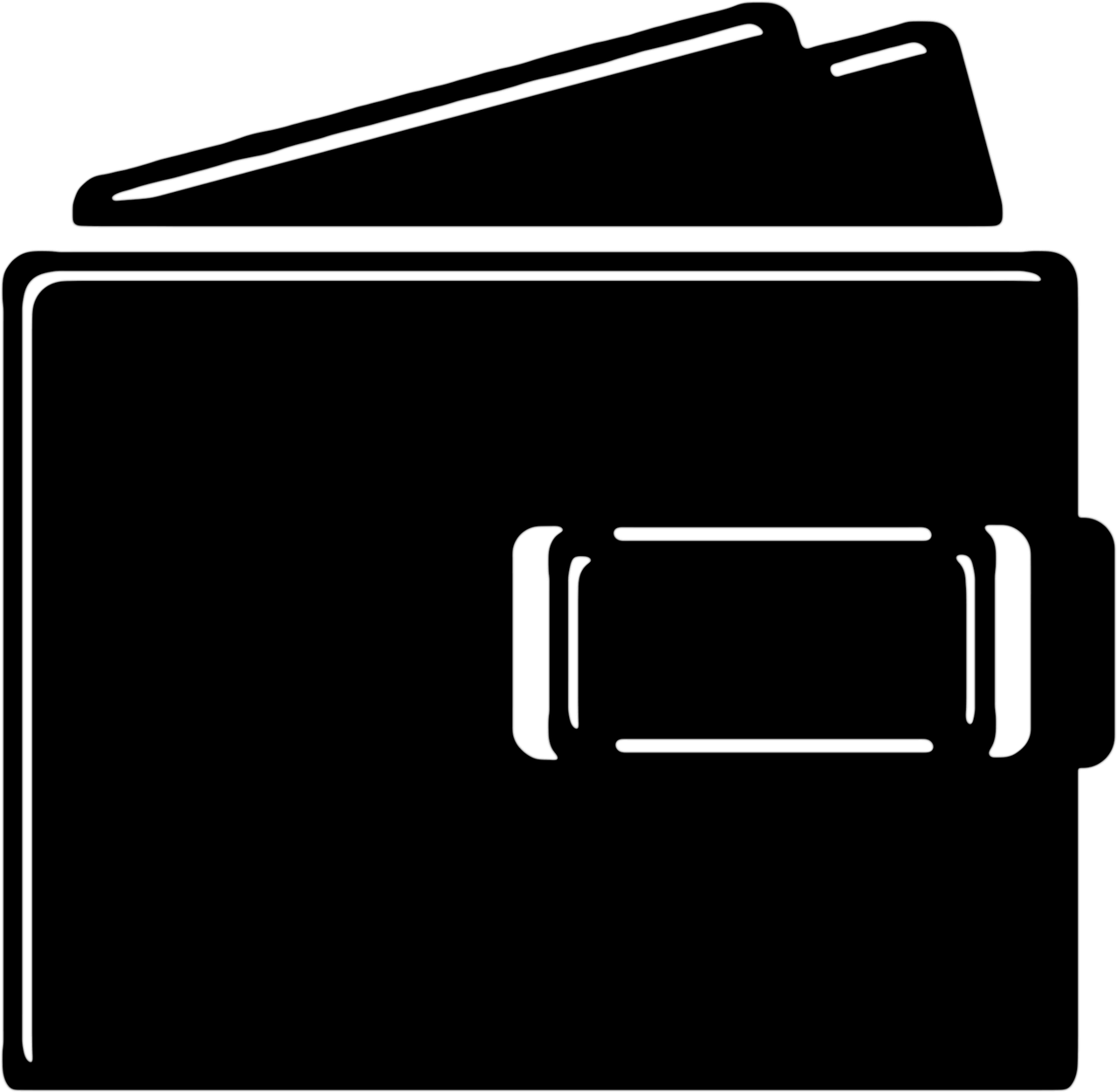
Clauses contractuelles et prévention : réduire au maximum les risques de non-paiement
Il est toujours préférable d’agir en amont pour limiter les impayés. L’insertion de clauses bien rédigées dans les contrats commerciaux est une arme préventive incontournable pour l’entreprise.
Trois types de clauses se révèlent particulièrement utiles :
- Les conditions de paiement claires : préciser les délais, modes de règlement acceptés, et exigences spécifiques.
- La clause pénale : prévoyant une pénalité automatique en cas de retard, ce qui sert d’effet dissuasif.
- La clause résolutoire : qui permet de résilier automatiquement le contrat après un certain délai de non-paiement suite à la mise en demeure.
Par exemple, un prestataire peut insérer dans ses Conditions Générales de Vente (CGV) une clause résolutoire stipulant que toute facture non payée dans les 15 jours suivant la mise en demeure entraînera la résiliation automatique du contrat, limitant ainsi le risque pour l’entreprise.
Pour une prévention efficace, d’autres bonnes pratiques méritent d’être suivies :
- Vérifiez systématiquement la solvabilité de vos nouveaux clients grâce à une assurance-crédit ou des services spécialisés.
- Demandez un acompte partiel avant le lancement de la commande.
- Effectuez un suivi rigoureux et des relances régulières dès le premier jour de retard.
- Gardez une traçabilité parfaite de toutes les communications avec le client, y compris par lettres recommandées.
- Respectez les délais de prescription (5 ans pour les professionnels et 2 ans pour les particuliers) afin de ne pas perdre vos droits.
Les liens suivants apportent des conseils pratiques pour maîtriser ces dispositifs : Dacodoc Services, Défends tes Droits.

Quiz – Recours en cas de non-paiement d’une commande
Recourir à la médiation et aux professionnels spécialisés pour gérer efficacement les impayés
Au-delà des moyens juridiques, la médiation s’impose de plus en plus comme une méthode efficace et humaine pour résoudre les litiges liés au non-paiement. Cette démarche extrajudiciaire vise à trouver un compromis satisfaisant pour les deux parties sans forcément passer devant un tribunal.
Le médiateur intervient souvent en amont ou même après une mise en demeure, facilitant la communication entre le fournisseur et le client défaillant. Cela évite des procédures longues et coûteuses et peut préserver la relation commerciale.
En parallèle, plusieurs professionnels peuvent être mobilisés :
- Les sociétés spécialisées en recouvrement amiable qui accompagnent dans les rappels et négociations précontentieuses.
- Les avocats experts en droit commercial qui sécurisent la rédaction des contrats et pilotent les procédures judiciaires.
- Les huissiers de justice, déjà évoqués, intervenant aussi à ce stade pour rappeler la gravité de la situation au débiteur.
Un restaurateur parisien, confronté à plusieurs commandes impayées récurrentes, a ainsi pu éviter un procès en médiant avec l’aide d’un professionnel, aboutissant à un échéancier valide.
Le recours à des professionnels diminue les risques d’erreurs procédurales et augmente les chances de récupérer les sommes dues rapidement et définitivement. En cas de besoin, vous pouvez consulter des conseils détaillés sur le site du cabinet Martin & Mrejen.
Questions fréquemment posées sur les recours en cas de non-paiement d’une commande
Quels sont les recours possibles si un client ne paie pas ?
Les recours vont des démarches amiables comme la mise en demeure et la médiation à la procédure judiciaire, notamment l’injonction de payer, le référé-provision, ou encore l’assignation au fond.
Que se passe-t-il lorsqu’un client refuse de payer malgré la mise en demeure ?
Le créancier peut entamer une procédure judiciaire. Le débiteur encourt des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire d’au moins 40 € selon l’article D.441-5 du Code de commerce, voire des sanctions administratives pouvant atteindre plusieurs millions d’euros.
Peut-on porter plainte pénalement contre un client pour non-paiement ?
Le non-paiement est en principe une procédure civile. Seules les situations d’escroquerie ou d’abus de confiance constituent des infractions pénales.
Quels sont les recours spécifiques pour un auto-entrepreneur ?
L’auto-entrepreneur bénéficie d’une procédure simplifiée pour des créances inférieures à 5 000 €, et peut faire appel sans avocat à l’injonction de payer ou faire appel à une société de recouvrement.
Que contient une mise en demeure efficace ?
Elle doit comporter l’identité des parties, le détail de la dette, un délai de paiement précis, la mention des intérêts moratoires, ainsi que la signature et la date d’envoi.


